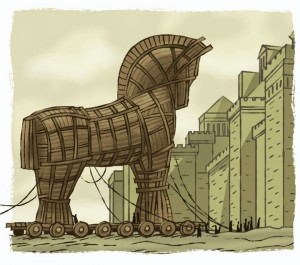Après avoir vu ce qu’était la guerre et pourquoi on la faisait, intéressons-nous maintenant à la façon de la faire.
L’idée majeure qui parcourt l’ensemble du traité, et où tous les préceptes de Sun Tzu peuvent trouver leur source, est la suprématie de la duperie :
« La guerre repose sur le mensonge. » (chapitre 1)
A noter que cette idée, présentée dès le premier chapitre, se voit re-explicitée et complétée plus loin dans le traité:
« La guerre a le mensonge pour fondement et le profit pour ressort. » (chapitre 7)
Le cadre d’emploi de la duperie est très large, voire systématique, et ce tant sur le plan temporel (avant et pendant l’affrontement) qu’à tous les niveaux de la guerre : politico-diplomatiques, stratégique, tactiques, voire sub-tactiques (individu isolé ou équipe). Le fait que Sun Tzu traite de la duperie jusqu’au niveau diplomatique donne d’ailleurs à sa conception de la guerre une dimension qui embrasse bien plus que le seul aspect strictement militaire du choc de deux entités (voir à ce propos notre billet Sun Tzu vs Clausewitz, Des périmètres d’étude de la guerre différents). Continuer la lecture