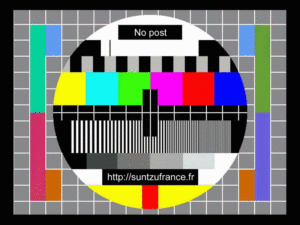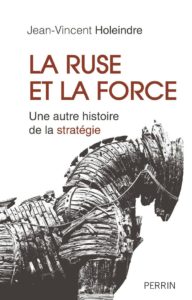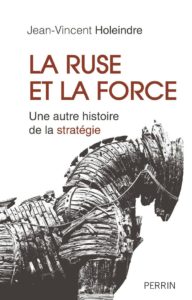
La ruse et la force, de J.-V. Holeindre
Billet inattendu : l’ouvrage dont il va être question ici ne parle quasiment pas de Sun Tzu. Mais il traite d’une des grandes thématiques suntzéennes : la ruse. Pourquoi, alors, Sun Tzu n’y est-il pas évoqué ? Parce que le sujet exact de l’ouvrage est l’histoire de la perception de la ruse en Occident.
Jean-Vincent Holeindre est directeur scientifique à l’IRSEM, l’Institut de Recherches Stratégique de l’École Militaire (le think tank du ministère français de la défense). Sur 464 pages, son ouvrage est une version retravaillée et enrichie d’une thèse soutenue en 2010. Le résultat est un texte limpide, grouillants de faits et d’analyses plus intéressantes les unes que les autres. Tout en se posant comme une somme sur le sujet, l’écriture reste de bout en bout très agréable, et la structure en chapitres bien circonscrits autorise un papillonnage au gré des centres d’intérêts de chacun.
Pas question ici de comparaison entre les modèles chinois et occidentaux, comme a pu le faire François Jullien dans son Traité de l’efficacité. Et pour cause : l’auteur cherche justement à déconstruire cette notion de « modèle occidental » dont la ruse serait exclue. La démonstration est clairement exposée : « Nous montrerons ce que la stratégie, dans le monde occidental, doit à la ruse, l’idée étant d’écrire sur la longue durée une histoire dialectique et généalogique de ses relations avec la force. Le choix d’une approche focalisée sur les sources « occidentales », plutôt qu’une histoire globale, connectée ou comparée, tient précisément aux enjeux épistémologiques de notre recherche : la thèse du modèle occidental de la guerre doit être contestée sur son terrain même, par le dépouillement de sources de première main. »
Tout au long de sa démonstration, chronologique, l’auteur utilise deux figures comme méthode paradigmatique[1] : Achille, qui doit ses victoires à sa seule force, et Ulysse, qui compense ses faiblesses par son intelligence et ses stratagèmes.
Continuer la lecture →
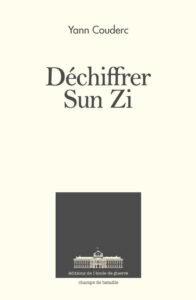 Aboutissement de toutes les recherches et réflexions partagées au fil des années sur ce blog, Déchiffrer Sun Zi marque la pierre finale de notre exploration de L’Art de la guerre.
Aboutissement de toutes les recherches et réflexions partagées au fil des années sur ce blog, Déchiffrer Sun Zi marque la pierre finale de notre exploration de L’Art de la guerre.