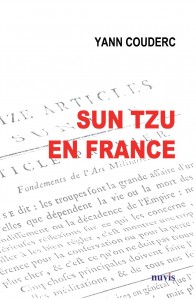Pour faire suite au billet Les personnages de L’art de la guerre, nous allons maintenant nous intéresser aux noms propres cités par Sun Tzu.
Les noms propres figurant dans L’art de la guerre sont tous employés comme antonomases[1] : ils ont valeur de noms communs, comme on dit « c’est un Hercule » sans que cela désigne le héros grec. Ainsi Yi Yin est-il le parangon des conseillers avisés ; il est mis en lieu et place d’ « habile stratèges» et de « sage conseiller » et n’a pas valeur de référence historique. De même Yue signifie simplement « pays éloigné » tout comme « Les gens de Yue et de Wou » symbolisent l’antagonisme le plus radical, les ennemis jurés. Pour comprendre ces images, toutes inconnues des Occidentaux, nous allons revenir sur chacun de ces noms propres.
« Les Yin durent leur triomphe à la présence de Yi Yin à la cour des Hsia, les Tcheou à celle de Liu Ya chez les Yin. » (chapitre 13)
Quelques explications s’imposent :
La dynastie des Yin (aussi appelée dynastie Shang) régna de 1600 à 1046 av. J.-C.. Elle succéda à celle des Hsia (ou Xia), qui régna de 2100 à 1600 av. J.-C.)[2], et précéda celle des Tcheou (ou Zhou), qui régna de 1046 à 256 av. J.-C.. Sachant que les dates varient beaucoup selon les sources… Un schéma valant mieux qu’une longue explication :