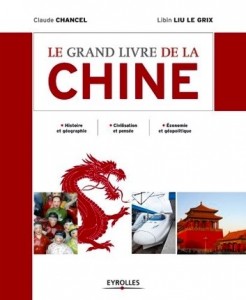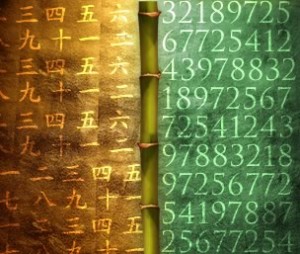La récente parution de l’ouvrage Le grand livre de la Chine va nous servir d’illustration pour évoquer un problème récurrent dans les fiches de lecture de L’art de la guerre : l’incompréhension de la nature chaotique du traité.
En effet, dans le cadre de son étude de la Chine, l’ouvrage consacre quelques pages au traité de Sun Tzu, le présentant en ces termes :
L’Art de la guerre est constitué de treize articles qui couvrent tous les sujets militaires pour mener à la victoire. Ainsi sont évoqués les thèmes de l’évaluation, de l’engagement, de la stratégie, des analyses du plein et du vide, des neufs changements, des attaques par le feu… Le livre enseigne les cinq facteurs de la réussite : [le dao, le ciel, la terre, le commandant et l’organisation.]
Ces propos reflètent, selon nous, une lecture totalement superficielle du livre relevant du simple survol mal compris. En effet, s’attacher à la structure des chapitres (ou articles) et y comprendre une réflexion organisée et structurée sur la guerre est une erreur : L’art de la guerre ne peut se lire comme un traité moderne, architecturé selon une logique démonstrative. Les propos, bien que rassemblés sous forme de chapitres, n’ont pas d’ordre précis ni de liens entre eux. L’art de la guerre doit être considéré comme un ensemble de maximes disparates, dont certaines se rassemblent il est vrai en paragraphes cohérents, pour lesquelles seule une lecture globale se détachant de la structure en chapitre permet de bien saisir le sens.