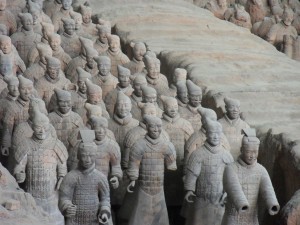Toute la réflexion de L’art de la guerre s’inscrit dans le cadre d’un univers de conscription. Sans armée professionnelle, le problème qui se pose au général est donc de transformer des paysans, n’y connaissant rien au maniement des armes, en militaires aptes à remporter des victoires. Sa solution n’est pas d’avoir une armée de métier, ni même d’instaurer un service militaire (comme le préconisait par exemple son contemporain Wu Zixu[1]), mais bien de faire avec la ressource, aussi inapte à la guerre soit-elle.
Nulle part Sun Tzu n’évoque le recours à l’entrainement, à une formation initiale du combattant. Encore moins si cet entrainement doit se faire en temps de paix ou au moment de la levée des troupes. La lecture de L’art de la guerre laisse entendre qu’il suffit de lever une armée de paysans et de bien les manœuvrer pour remporter la guerre. Or pour bien manœuvrer les troupes, il convient que ces dernières soient bien entrainées.
Comment donc le paysan se transforme-t-il en soldat ? Bien que cela ne soit pas explicitement énuméré, il nous apparaît que cette transformation s’appuie sur quatre procédés :
- le charisme du général ;
- la vertu ;
- la carotte et le bâton ;
- la mise des hommes dans une situation mortelle.
Le premier de ces piliers réside dans la capacité du général à être obéi de ses troupes :
« Qui sait commander aussi bien à un petit nombre qu’à un grand nombre d’hommes sera victorieux. Celui qui sait harmoniser la volonté des inférieurs et des supérieurs aura la victoire. » (chapitre 3)
Nous avons récemment consacré un billet à cette thématique du charisme du général, nous n’y reviendrons donc pas.