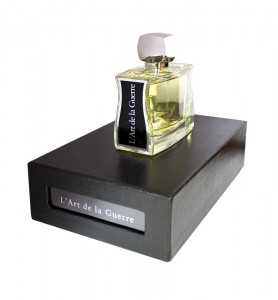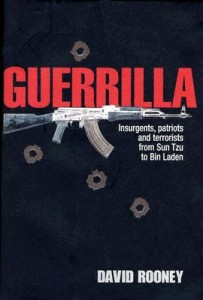Nous venons de voir que Sun Tzu présentait en chapeau de son traité sa vision du phénomène guerrier :
« La guerre est la grande affaire des nations ; elle est le lieu où se décident la vie et la mort ; elle est la voie de la survie ou de la disparition. On ne saurait la traiter à la légère. » (chapitre 1)
Cette assertion n’est toutefois pas la seule à exposer une réflexion sur le fait guerrier. Il est en effet possible de trouver le véritable « pourquoi ? » de la guerre au beau milieu du traité.
Pourquoi fait-on la guerre, donc ? Pas pour se protéger, ni pour défendre des valeurs, ni même pour rétablir un équilibre rompu. Non. Sun Tzu est beaucoup plus pragmatique (et honnête ?) que cela : la raison de faire la guerre, c’est le profit !
« La guerre a le mensonge pour fondement et le profit pour ressort. » (chapitre 7)
Curieusement, on s’attendrait à trouver une affirmation d’une telle ampleur en tête du premier chapitre, à l’instar de celle que nous avons citée précédemment. L’arrivée tardive de cette vérité fondamentale est très probablement due à la composition chaotique de L’art de la guerre évoquée dans le billet De quand date le texte de L’art de la guerre que nous connaissons ? et, répétons-le, aux modes de pensée différents entre l’Asie et l’Occident : à quelques exceptions près, il n’y a pas de démonstration cartésienne et structurée dans L’art de la guerre. Seulement une succession de préceptes, bien souvent en désordre.
Le profit est donc, pour Sun Tzu, le but ultime de la guerre. Profit de l’Etat, bien que cela ne soit pas explicitement précisé, étant donné que Sun Tzu pense l’action du général par rapport aux conséquences sur l’Etat :
« Celui qui lance ses offensives sans rechercher les honneurs et bat en retraite sans craindre les châtiments, mais qui, attaché aux intérêts du Prince, a pour unique ambition la défense de ses peuples, peut être considéré comme le Trésor du Royaume. » (chapitre 10)