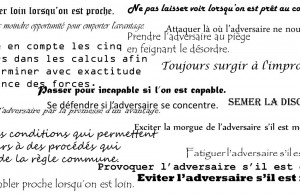« Si des troupes peuvent parcourir mille lieues tout en restant fraîches et disposes, c’est qu’elles ne rencontrent pas d’ennemi sur leur chemin. » (chapitre 6)
Cette maxime semble relever de la tautologie.
Elle recèle cependant une véritable profondeur. Pour s’en rendre compte, mettons-la en rapport avec les propos qui la suivent :
« Si des troupes peuvent parcourir mille lieues tout en restant fraîches et disposes, c’est qu’elles ne rencontrent pas d’ennemi sur leur chemin. Qui emporte toutes les places qu’il attaque investit des villes qui ne sont pas défendues. Qui tient toutes les places qu’il défend défend des places qui ne sont pas attaquées. Car nul n’est capable de repousser une offensive bien conduite, ni de briser une défense supérieurement menée. »
Succession d’évidences ? Pas du tout ! Ce que nous dit ici Sun Tzu, c’est qu’il ne faut pas rechercher les points durs, mais au contraire passer par les faiblesses du dispositif.