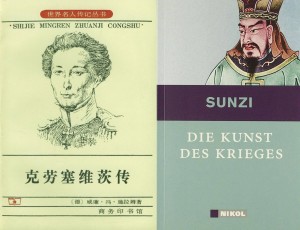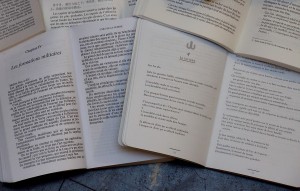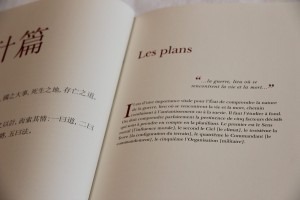Nous l’avons vu dans les billets précédents, Sun Tzu et Clausewitz abordent leur sujet de deux manières différentes. En découle que les thèmes traités ne se correspondent pas forcément. Bon nombre d’idées ne sont ainsi développées que par l’un ou l’autre : l’armée qui doit être comme l’eau pour Sun Tzu, le concept de friction pour Clausewitz, … Quand les thèmes concordent, les analyses des deux stratèges peuvent alors converger (même si les façons de les énoncer peuvent être très distinctes), différer, voire, plus rarement, être en franche opposition.
Un certain nombre d’idées sont donc similaires chez Sun Tzu et Clausewitz. Par exemple, pour les deux stratèges, le rapport de force se crée fondamentalement et de manière instable et délicate dans le rapport affectif du peuple et du souverain, ainsi que du peuple sous les armes et du commandement militaire, rapports qui dans un camp (plus que dans l’autre) permettent, le moment venu, de demander à la population un effort exceptionnel. Les formulations sont dans la forme très différentes, mais l’idée reste la même.