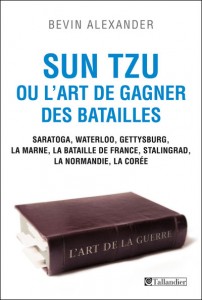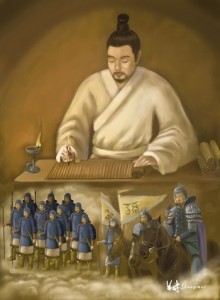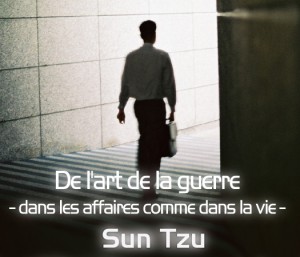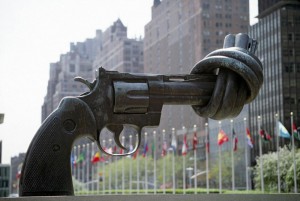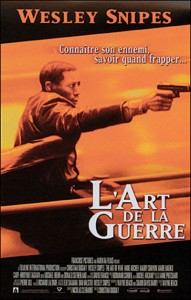Un livre majeur vient tout juste de paraître aux éditions Tallandier : Sun Tzu ou l’art de gagner des batailles, de l’Américain Bevin Alexander.
Il s’agit d’une traduction (signée Jacques Bersani) de l’ouvrage Sun Tzu at Gettysburg. Son auteur, Bevin Alexander, est un historien américain spécialiste de stratégie militaire. Paru en 2011, Sun Tzu at Gettysburg est son douzième et dernier ouvrage, le seul à avoir été traduit en français.
L’objectif que se donnent ces 296 pages est « de montrer que les chefs militaires qui, durant les deux derniers siècles, lors d’affrontements majeurs, ont suivi sans le savoir les axiomes de Sun Tzu ont connu le succès, tandis que ceux qui ne les respectaient pas étaient voués à la défaite, et quelquefois à des désastres ou à des catastrophes conduisant à la perte pure et simple de la guerre ». Pour cela, l’auteur a étudié neuf batailles à travers le prisme des enseignements de Sun Tzu : Saratoga (1777), Waterloo (1815), les campagnes de la guerre de Sécession de 1862, Gettysburg (1863), la bataille de la Marne (1914), la bataille de France (1940), Stalingrad (1942), la libération de la France (1944) et l’invasion de la Corée du Nord (Incheon, 1950).