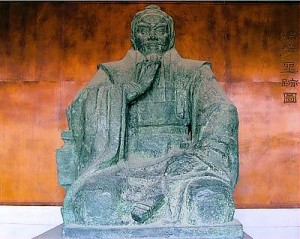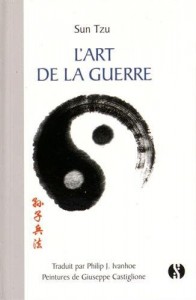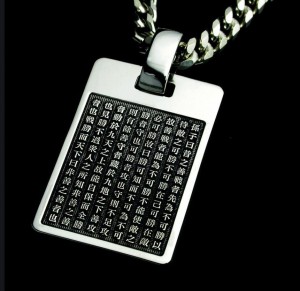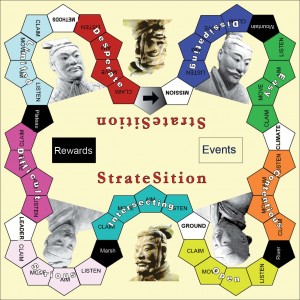A l’instar des fonctionnaires civils, le recrutement des officiers se fera jusqu’en 1905 – date de l’abolition des examens impériaux – par concours administratifs ; concours fondés sur quelques épreuves pratiques (contrôle des qualités de cavalier et d’archer), mais surtout sur une connaissance totalement livresque des classiques chinois de la stratégie, au premier rang desquels figurait L’art de la guerre de Sun Tzu. Nous nous proposons ici de revenir sur les 2000 ans d’immobilisme qu’a connu la pensée stratégique chinoise. Nous nous appuierons largement pour cela sur les études de Valérie Niquet, et notamment son opuscule Les fondements de la stratégie chinoise (éditions Economica, 1997).
En réaction contre les excès militaristes de la première dynastie légiste des Qin, et contre les siècles de combats incessants qui avaient précédé la fondation de l’Empire, la dynastie des Han s’est tout de suite appuyée sur une réhabilitation d’idées confucianistes (« réhabilitation », bien qu’elles n’avaient en fait jamais été mises en pratique). Élevé au rang d’idéologie d’État (même si par endroit réinterprété par le pouvoir impérial…), le confucianisme a constitué le fondement officiel du bon gouvernement du pays. Ce courant de pensée, sur lequel se basait aussi le recrutement des fonctionnaires, a dès lors placé tout ce qui touchait au domaine de la guerre dans une position totalement subordonnée par rapport au civil. Ainsi les vertus militaires étaient-elles particulièrement dédaignées et les fonctionnaires militaires, pourtant très « civilisés », étaient-ils considérés comme hiérarchiquement inférieurs aux fonctionnaires civils.
En effet, la guerre, et par extension le militaire, signifiait l’irruption de la violence déstabilisatrice dans la société, signe du non-respect des rites et des vertus morales ; elle annonçait, au même titre que les tremblements de terre ou les comètes, la sanction du prince : la perte du « mandat du ciel », qui pouvait déboucher sur le renversement de la dynastie. Pour comprendre cela, il convient de revenir à la situation géostratégique de l’Empire du milieu, qui a profondément affecté sa perception de ce que pouvaient être une guerre : pendant près de 2000 ans, la Chine, en tant qu’entité culturelle comprenant également les dynasties « barbares » progressivement sinisées, comme les Yuan mongols au XIIIe siècle ou les Qing mandchous à partir du XVIIe siècle, ne se concevra plus vraiment d’ennemi extérieur digne de sa puissance. Chaque guerre sera ainsi perçue comme la répression d’un acte de rébellion contre l’ordre du monde « sous le ciel » : l’usage de la force n’était toléré que pour remédier à la transgression de l’ordre civilisé, qu’il s’agisse d’une incursion barbare, d’un soulèvement paysan, d’une association de brigands ou d’une tentative de renversement de la dynastie. La pensée stratégique se fondant sur la perception que l’on a de ce qu’est « l’autre », l’emploi des militaires se percevra dès lors plus comme une opération de police que comme une véritable guerre. En période d’hostilité, à l’intérieur de l’Empire comme sur ses marges, le gouvernement préférait de toute façon choisir une solution politique, fondée sur des incitations économiques et des pressions diplomatiques, plutôt qu’une solution purement militaire de dernier recours (à noter qu’il s’agit encore aujourd’hui de la stratégie adoptée par la Chine dans ses relations avec ses voisins proches ou lointains).