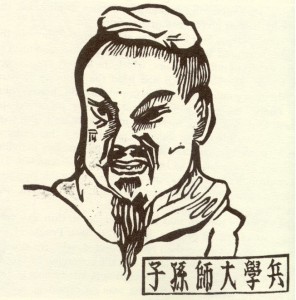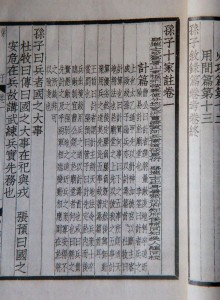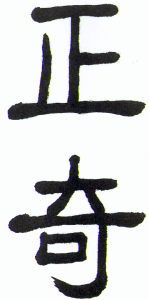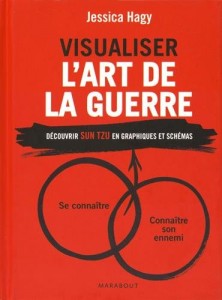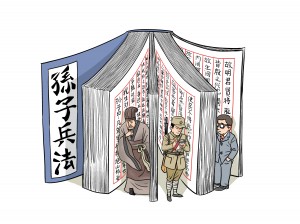En recherchant le pragmatisme et l’efficacité, Sun Tzu parvient à se détacher grandement du bain sociétal de son époque. L’exemple le plus emblématique en est probablement son rejet des croyances religieuses :
« La prévision ne vient ni des esprits ni des dieux ; elle n’est pas tirée de l’analogie avec le passé pas plus qu’elle n’est le fruit des conjectures. Elle provient uniquement des renseignements obtenus auprès de ceux qui connaissent la situation de l’adversaire. » (chapitre 13)
« Faites taire les rumeurs, proscrivez les sorts et vos hommes vous suivront jusque dans la mort. » (chapitre 11)
Ce pragmatisme est une des principales raisons de l’intemporalité du traité, mais s’avère également source d’un possible rejet pour cause d’« immoralité ». Il en est ainsi de sa préconisation du pillage :
« En appâtant [ses hommes] par la promesse de récompenses, [le général] les incite à attaquer l’ennemi pour s’emparer du butin. » (chapitre 2)
…ou de son injonction de placer ses propres hommes dans des situations désespérées pour les obliger à se battre comme des lions.
« On jette [ses soldats] dans une situation sans issue, de sorte que, ne pouvant trouver le salut dans la fuite, il leur faut défendre chèrement leur vie. Des soldats qui n’ont d’autre alternative que la mort se battent avec la plus sauvage énergie. N’ayant plus rien à perdre, ils n’ont plus peur ; ils ne cèdent pas d’un pouce, puisqu’ils n’ont nulle part où aller. » (chapitre 11)