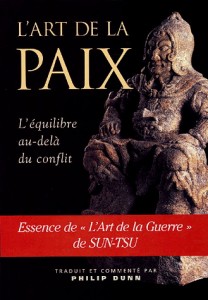La traduction d’un texte chinois vieux de plus de 2000 ans est particulièrement complexe. Le meilleur moyen de s’en rendre compte est de lire la toute première version de Valérie Niquet datant de 1988, qui était à bien des endroits relativement inintelligible, témoignant des difficultés de sa traductrice à faire émerger du sens d’une telle succession de caractères polysémiques. Nous allons le voir, les caractéristiques de la langue utilisée expliquent en effet grandement les difficultés rencontrées par les traducteurs.
L’étude de la version du Yinqueshan nous fournit une assez bonne idée de ce que pouvait être le traité à ses débuts. Nous avons en effet là un texte écrit dans une forme très ancienne de chinois, dite « chinois classique ». Concise à l’extrême, la structure de cette langue ne permettait guère d’exprimer clairement une idée, laissant au contraire bien souvent au lecteur le soin de la deviner. Si cette plasticité convenait très bien à la poésie, elle ne permettait a contrario pas de transmettre explicitement des notions précises ou subtiles.
En réalité, le mot « traduction » est presque impropre vis-à-vis du chinois classique. Il serait plus exact de parler d’ « interprétation », tant les vides laissés par cette langue pourraient être comblés de toutes sortes de façons.
Les différences d’interprétation paraissent dès lors inévitables. Ainsi, selon Samuel Griffith, pour certains commentateurs, le « pillez en terre de diligence » du chapitre 11 devrait au contraire se lire « ne pillez pas ». Certaines maximes sont toujours ainsi toujours controversées quant au sens à leur donner :
« L’armée d’un roi dominateur attaque-t-elle une grande principauté que celle-ci se trouve dans l’incapacité de rameuter ses hommes, fait-elle planer une menace sur un de ses voisins que les autres puissances n’osent nouer avec lui des alliances. » (chapitre 11)
Les commentateurs s’opposent en effet sur le camp avec lequel les autres puissances n’osent pas nouer d’alliance : celui de l’attaquant ou celui de l’attaqué ?
C’est ainsi que le sens doit parfois être deviné, au risque sinon d’en être incompréhensible. Comment par exemple interpréter cette traduction de Valérie Niquet :
« En général, lorsqu’on décide de déployer ses troupes pour faire face à l’ennemi il faut longer les ravins pour couper à travers une montagne, il faut se placer sur une hauteur pour voir le soleil s’élever ; il ne faut pas avoir à grimper lorsque l’on combat un ennemi en altitude. Telle est la manière de disposer une armée dans les montagnes. » (chapitre 9)
Idée guère compréhensible, que la traduction de Jean Lévi rend de façon plus claire :
« Traversant les montagnes, on suivra les vallées et on choisira son camp à l’adret d’une hauteur ; on doit toujours chercher à combattre en position dominante et éviter d’avoir à monter à l’assaut. Telles sont les dispositions pour une armée en montagne. »
Le père Amiot avait déjà parfaitement saisi toute la difficulté à rendre cette langue, d’où son choix de se référer à un texte en mandchou, plus facile à traduire avec exactitude. Il estimait ainsi dans son discours préliminaire :
Cette langue singulière, que les Japonais appellent la Langue de confusion, ne présente que des difficultés à un Européen, sous quelque point de vue qu’il l’envisage. Les caractères qui sont faits pour exprimer les idées chinoises, sont comme ces belles peintures dans lesquelles le commun, ou les connaisseurs médiocres ne voient qu’en gros l’objet représenté, ou tout au plus une partie des beautés qu’elles renferment, tandis qu’un vrai connaisseur y découvre toutes celles que l’Artiste a voulu exprimer.
Une bonne illustration de toute la latitude existant dans la transcription de L’art de la guerre peut être trouvée à travers l’étude d’une traduction plus iconoclaste de Sun Tzu, celle du Britannique Philip Dunn (traduit par Josette Nickels-Grolier en 2004). Sous le titre L’art de la paix, Philip Dunn s’est en effet essayé à une transcription différente du texte chinois, pacifiste, jouant sur la polysémie des caractères chinois :
Du fait de l’opportunité constamment offerte par les [multiples significations des pictogrammes chinois], le traducteur se voit offert une grande flexibilité dans le choix des interprétations qu’il désire privilégier, et c’est cette opportunité qui a emmené l’auteur à comprendre que L’art de la guerre pouvait aussi être, et devrait en fait être, L’art de la paix.
Cette interprétation amène à une traduction radicalement différente du texte. A titre d’exemple, Philip Dunn traduit ainsi les premières phrases de Sun Tzu :
« Le conflit et la coexistence pacifique sont deux aspects fondamentaux de la vie – ils constituent les bases véritables de la survie – qui génèrent, tous les deux, destruction et créativité. Nous devons donc les examiner de plus près. Etudiez l’art de la paix en accord avec les cinq principes fondamentaux – le Tao (l’amour), le ciel sur terre (la conscience), la vigilance, le silence, le pouvoir. Développez des méthodes faisant usage des cinq principes pour savoir faire face à tous les évènements. »
Là où Jean Lévi a traduit :
« Maître Sun a dit : La guerre est la grande affaire des nations ; elle est le lieu où se décident la vie et la mort ; elle est la voie de la survie ou de la disparition. On ne saurait la traiter à la légère. La guerre est subordonnée à cinq facteurs ; ils doivent être pris en compte dans les calculs afin de déterminer avec exactitude la balance des forces. Le premier est la vertu, le deuxième le climat, le troisième la topographie, le quatrième le commandement, le cinquième l’organisation. […] Un général en chef doit tenir compte de tous ces facteurs dans leur ensemble. Il sera victorieux s’il les maîtrise. Il sera battu s’il ne les maîtrise pas. »
Nous voyons donc ainsi combien les caractéristiques de la langue classique constituent un facteur déterminant des différences observées entre les traductions françaises de L’art de la guerre.