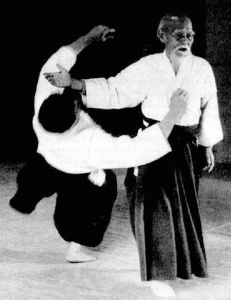Il n’est pas immédiat de comprendre si Sun Tzu considère ou non que le soldat a de l’importance. En effet, d’un côté il annonce qu’il faut aimer ses hommes :
« Pour peu que leur chef les aime comme un nouveau-né et les chérisse comme un fils bien aimé, les soldats seront prêts à le suivre en enfer et à lui sacrifier leur vie. » (chapitre 10)
Et de l’autre il ne semble pas leur accorder plus de considération qu’à du bétail :
« Il incombe [au général] d’obstruer les yeux et les oreilles de ses hommes pour les tenir dans l’ignorance. […] Il occupe [la multitude de ses armées] avec des tâches et ne s’embarrasse pas de lui en expliquant le pourquoi ; il l’excite par la perspective de profits en se gardant bien de la prévenir des risques. » (chapitre 11)
Qu’en est-il donc réellement ?
Sun Tzu considère que « la position stratégique » est prépondérante sur les qualités guerrières de la troupe :
« L’habile homme de guerre s’appuie sur la position stratégique et non sur des qualités personnelles. C’est pourquoi il sait choisir les hommes et jouer des dispositions. […] Celui qui sait employer ses hommes au combat leur insuffle la puissance de pierres rondes dévalant les pentes abruptes d’une montagne haute de dix mille pieds. Telle est l’efficacité de la configuration stratégique. » (chapitre 5)