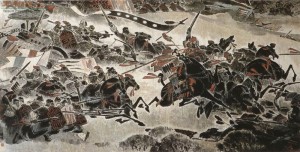Les forces « régulières » (« zheng » en chinois, 正, prononcez « djung ») et les forces « extraordinaires » (« qi », 奇, prononcez « tchi ») sont un aspect essentiel du système suntzéen. Elles sont traitées dans le chapitre 5 :
« En règle générale, on use des moyens réguliers au moment de l’engagement ; on recourt aux moyens extraordinaires pour emporter la victoire. » (chapitre 5)
Si la compréhension la plus immédiate et naturelle assigne les forces régulières au combat « conventionnel » et les forces extraordinaires aux combats de guérilla (c’est par exemple la lecture qu’en avait le stratège chinois contemporain Liu Bocheng[1]), nous pouvons observer que Sun Tzu se refuse à définir et donc à figer les fonctions de ces deux types de forces. Peut-être parce que cela est évident pour lui, mais peut-être également parce qu’elles peuvent en réalité très bien se transformer l’une en l’autre : c’est par sa fonction et non par sa nature qu’une force serait alors considérée comme normale ou extraordinaire :
« Bien qu’il n’y ait que cinq notes, cinq couleurs et cinq saveurs fondamentales, ni l’ouïe, ni l’œil, ni le palais ne peuvent en épuiser les infinies combinaisons. De même, bien que le dispositif stratégique se résume aux deux forces, régulières et extraordinaires, elles engendrent des combinaisons si variées que l’esprit humain est incapable de les embrasser toutes. Elles se produisent l’une l’autre pour former un anneau qui n’a ni fin ni commencement. Qui donc pourrait en faire le tour ? » (chapitre 5)