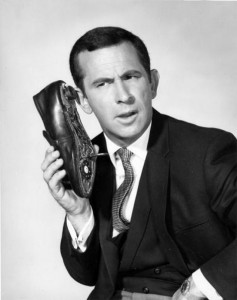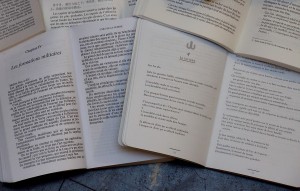Si, comme nous l’avons vu dans le billet précédent, Sun Tzu évoque les espions pour acquérir le renseignement sur l’ennemi, ce n’est pas le seul moyen. Les éclaireurs, qui fournissent une information d’intérêt plus immédiat, témoignent également d’une démarche de recherche active du renseignement :
« Qui ne sait recourir aux éclaireurs sera incapable de tirer parti des avantages du terrain » (chapitre 11)
Outre l’espionnage, un autre procédé peut être déduit des propos de Sun Tzu pour acquérir cette connaissance de l’adversaire : la manœuvre, les reconnaissances et les coups de sonde :
« Examinez les plans de l’ennemi pour en connaître les mérites et démérites ; poussez-le à l’action pour découvrir les principes de ses mouvements ; forcez-le à dévoiler son dispositif afin de déterminer si la position est avantageuse ou non ; harcelez-le afin de repérer ses points forts et ses points faibles. » (chapitre 6)