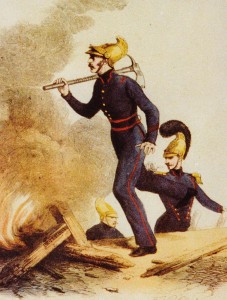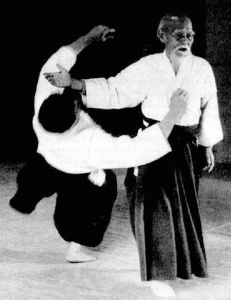Le thème de l’honneur est un d’un abord relativement délicat dans L’art de la guerre. En effet, Sun Tzu y réserve un usage différent suivant que le terme est utilisé dans son acceptation de « gloire, considération des autres » ou dans celle de « réputation, fierté personnelle ». Tout en considérant qu’un grand général doit être honoré pour ses victoires, ce dernier ne doit cependant pas être mû par son honneur.
Bien sûr, les grands généraux méritent d’être « honorés » et d’être « couverts de gloire » :
« Un prince avisé et un brillant capitaine sortent toujours victorieux de leurs campagnes et se couvrent d’une gloire qui éclipse leurs rivaux grâce à leur capacité de prévision. » (chapitre 13)
Ce qui fait qu’un général mérite d’être honoré, c’est qu’il est victorieux. Mais si la « victoire » est l’objectif du chef militaire (le mot est utilisé 39 fois à travers le traité), souvenons-nous toutefois que l’objectif suprême est d’être victorieux en ayant fait couler le moins de sang possible (cf. notre billet Sun Tzu est-il un théoricien de la non-guerre ?).
La recherche de cette victoire, en un minimum de violence, se fait dès lors par tous les moyens. Seule compte la victoire. A ce titre, L’art de la guerre dépasse toute considération moralisante, tout code d’honneur. Sun Tzu va jusqu’à exalter des techniques telles que la trahison ou la corruption (appelées « mensonge » ou « stratagème » dans L’art de la guerre). Il n’est pas de « droit des conflits armés » : tous les moyens sont bons pourvu qu’ils assurent la victoire. La fin justifie les moyens…