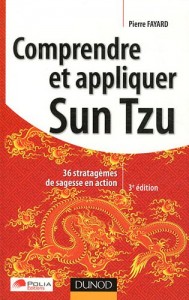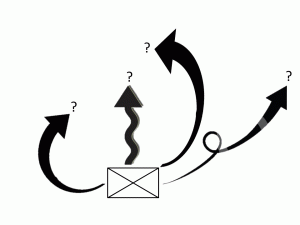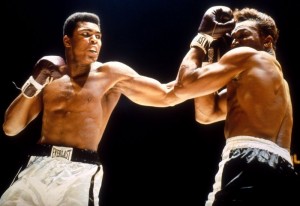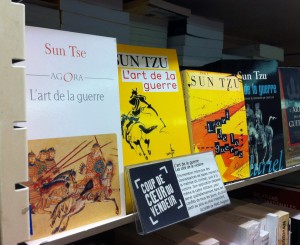Dans le numéro d’octobre 2011 des Cahiers du CESAT, Martin Motte publiait un (excellent) article sur Sun Tzu.
Quelle bouffée d’air !
Pour une raison que nous ne parvenons pas à nous expliquer, l’étude militaire française de L’art de la guerre est en effet totalement délaissée. Un indicateur de ce désintérêt peut être trouvé dans la Revue Défense Nationale, référence de la pensée militaire fondée en 1939 : une prospection sur l’ensemble des articles publiés depuis sa création n’en livre que cinq ayant trait à L’art de la guerre[1]. Et encore, trois sont de notre fait. C’est bien maigre…
Pire : trois ouvrages français ont, jusqu’à présent, affirmé se livrer à une exégèse de Sun Tzu : Relire L’art de la guerre de Sun Tzu de Jean-François Phélizon, Comprendre et appliquer Sun Tzu de Pierre Fayard et Décoder & comprendre L’art de la guerre de Gabriel Lechevallier. Or aucun d’eux ne répond à l’objectif annoncé.